Retracer le parcours spirituel, personnel, politique d’Hokusai, célèbre peintre japonais de l’ère d’Edo, c’est l’ambition du cinéaste Hajime Hashimoto dans un film éponyme, paru en 2020 dans le pays natal de l’artiste. Est-il parvenu à mettre en lumière la personnalité discrète de ce « fou du dessin » persuadé qu’il accéderait à la sagesse une fois centenaire ?
S’il pouvait sembler évident de faire d’une figure aussi incontournable et intemporelle que Katsuhika Hokusai le sujet d’un biopic, l’exercice s’annonçait en fait très périlleux.
D’une part, les biographies à son sujet ne s’accordent pas toutes, ne serait-ce que sur sa date de naissance. Impossible dès lors pour Hajime Hashimoto de proposer une copie scolaire et appliquée, qui rendrait scrupuleusement et chronologiquement compte de la vie de l’artiste.

De surcroît, raconter Hokusai ne saurait souffrir d’aucune excentricité. L’homme était un ascète, dont le souvenir de la peinture a tout entier avalé le souvenir du peintre. Sa destinée n’est d’ailleurs pas composée de moments, de remous, de chutes ou de rédemptions. Elle est au contraire une ballade à la trajectoire (presque) linéaire s’achevant par la mort d’un vieillard devenu sagace.
Enfin, Hokusai a vécu 88 ans lors de l’ère d’Edo, l’une des époques les plus bouillonnantes de l’histoire du Japon. Conter son histoire, c’est aussi parler d’un Japon à la veille de soulèvements contre le shogunat, d’une époque qui voit l’imprimerie faire des progrès fulgurants, ou écouter les murmures qui se faufilent dans les couches intimistes des courtisanes du quartier des plaisirs de Yoshiwara.

Ces difficultés, Hajime Hashimoto les déjoue soigneusement. D’abord en s’éloignant du rythme classique et chronologique du biopic.
Ce dernier décide ainsi de croquer dans un premier mouvement l’artiste dans une jeunesse fougueuse avant de le montrer au crépuscule de son existence ; ces deux périodes sont séparées par une ellipse.
Il s’agit pour le réalisateur de décrire la vie du maître comme le cycle d’une année. Ce mouvement poétique, oscillant entre le printemps bourgeonnant d’un artiste effronté et l’hiver crépusculaire d’un maître en transe, est largement mis en avant par la mise en scène. Nerveuse et agitée durant le premier acte (à l’image du contexte sociohistorique qu’elle explique avec une précision ciselée), elle devient plus contemplative et métaphorique par la suite.

Raconter plusieurs Hokusai nécessitait ainsi plusieurs interprètes. Le jeune sera campé par l’excellent Yūya Yagira, habitué à l’exercice après avoir interprété Takeshi Kitano dans Asakusa Kid. C’est toutefois Min Tanaka (un homme césarisé au Japon à la carrière exceptionnellement hétéroclite, allant de 47 Ronin à Amer Béton) qui s’impose comme l’étoile du film. Sa palette d’émotions est idoine. Solennel ou possédé, solitaire ou sociable, père absent ou mentor missionné, tout lui sied autant que l’estampe.
On notera enfin la performance d’Hiroshi Abe dans le rôle de Juzaburo Tsutaya, un éditeur historique et Pygmalion de son époque (dont on ne mettrait d’ailleurs pas notre main à couper qu’il a factuellement collaboré avec Hokusai).

Tout ce petit monde incarne un tableau extrêmement vivant dans un Japon chahuté et parfaitement recomposé. Les costumes sont somptueux, les décors jouissifs, et la photographie ne permet que d’apprécier encore plus le soin apporté à l’artisanat d’Hokusai.
La part belle est laissée à l’art, sans laisser de côté ses artisans. Dans l’intimité d’une couche feutrée de Yoshiwara, dans une imprimerie bruyante, ou à même le sol d’une bicoque, le dessin, la peinture, la sculpture ou le théâtre sont dignement représentés.
90 minutes sont étonnamment suffisantes (nous y reviendrons) pour adresser des problématiques pertinentes sans tomber dans le piège de faire de La grande vague de Kanagawa un trop gros évènement pour le peintre (avec près de 30.000 travaux à son actif, il n’a pas réalisé La grande vague dans un esprit particulier).

Sauf qu’Hokusai ne dure pas 90 minutes. Si le matériel presse de son distributeur, Art House (une fantastique société de distribution au demeurant), n’indique rien à ce sujet, de nombreuses mentions d’une mouture de 129 minutes, disponible au Japon, font surface sur la toile.
De quoi se demander, pourquoi Hokusai hérite-t-il d’un charcutage de près de 40 minutes ? Parfaitement digeste, d’une narration fluide, qu’est-ce qui a motivé sa société de distribution dans l’Hexagone à le rogner de la sorte ?
À défaut d’avoir une réponse à cette question, nous pouvons toujours imaginer ce qui a été prélevé. Peut-être une dissertation plus étoffée sur le Japon à l’ère d’Edo et ses persécutions infligées aux artistes qui sortaient du cadre imposé par le shogunat, ou encore le récit des rencontres entre Hokusai et l’étranger, en particulier les Pays-Bas.

Note : 3,5/5. Efficace, inspiré, méthodologiquement brillant et incarné avec justesse, il ne manque pas grand-chose à Hokusai pour être un excellent biopic. Jamais avare lorsqu’il s’agit de nous montrer du beau, dans ses reproductions de peintures ukiyo-e comme dans son artisanat, l’amputation de près d’un tiers du film demeure incompréhensible.
En attendant, il est capital de soutenir son distributeur français, Art House. Hokusai est disponible en salle depuis le 26 avril 2023. Pour les plus récalcitrants, la bande-annonce saura vous convaincre.
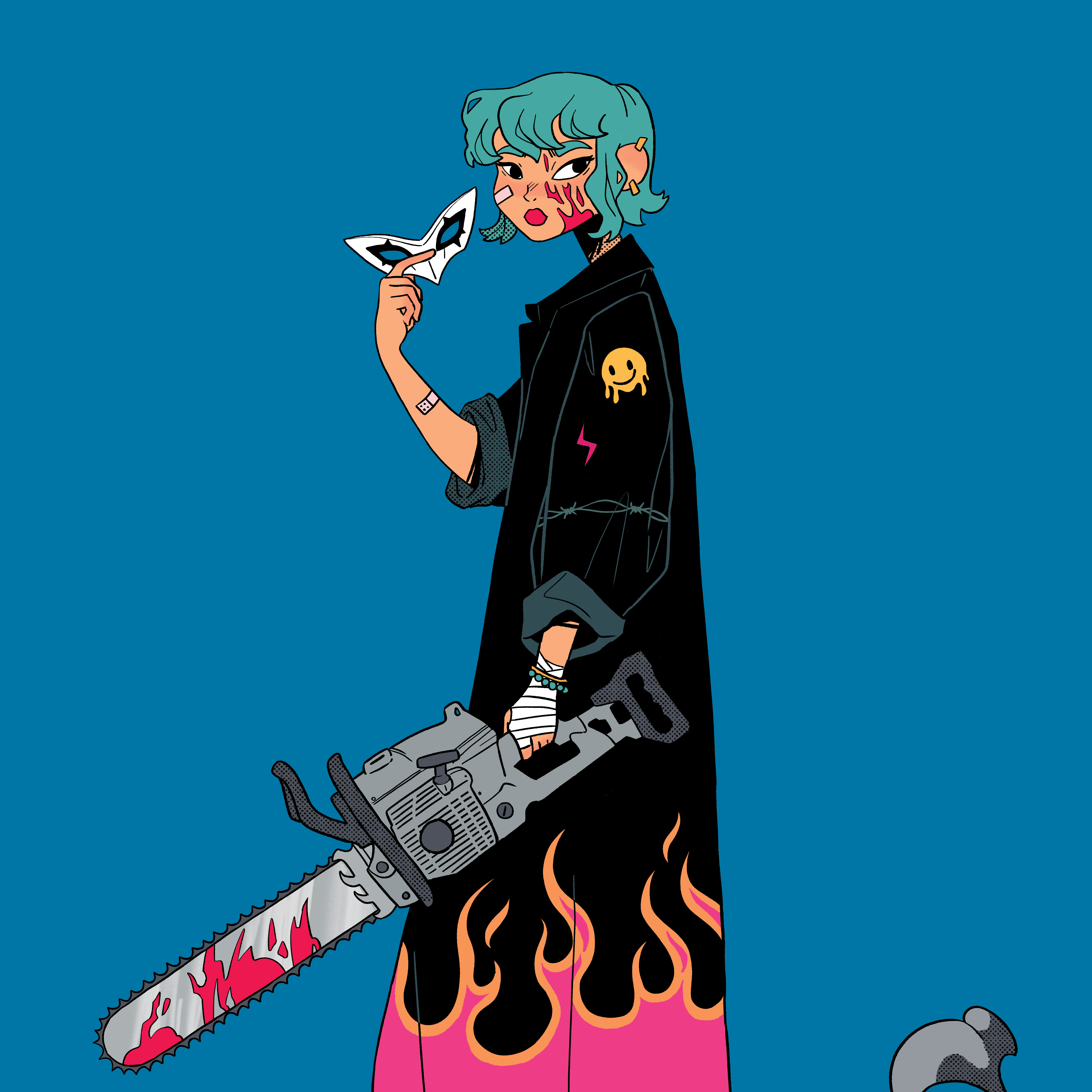

Laisser un commentaire